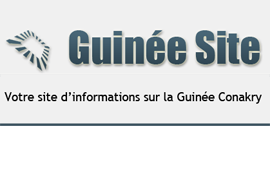Ebola : "La pire erreur que l’on puisse faire à propos du virus Ebola est de le sous-estimer ou de croire que l’on sait tout sur lui"
Expert en maladies infectieuses, Mosoka Fallah revient dans The Conversation sur les leçons qu'il faut tirer du passé depuis le retour d'Ebola, notamment en Guinée.
En Guinée, Ebola frappe à nouveau. La dernière flambée en Afrique de l’Ouest s’était produite entre 2014 et 2015 et avait touché le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée. Cette épidémie d’Ebola, la plus meurtrière au monde, avait justement débuté en Guinée. Elle avait fait plus de 11 300 morts, dont plus de 500 professionnels de santé.
Mais sept ans plus tard, la situation des pays d’Afrique de l’Ouest est très différente.
Indication claire que la volonté politique de stopper l’épidémie est bel et bien là, le Liberia et la Sierra Leone ont déjà mobilisé et activé leurs plans nationaux de réponse.
Les pays de la région bénéficient non seulement de l’expérience du passé, mais aussi de nouveaux outils pour lutter contre le virus Ebola. Ils disposent d’une main-d’œuvre expérimentée, de réseaux de laboratoire plus développés. Les organisations régionales, telles que l’Union du fleuve Mano, un organisme régional chargé des questions économiques et de sécurité, ou la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), sont également plus proactives.
En 2018, par exemple, une réunion de planification s’est tenue à Freetown, en Sierra Leone, afin de préparer la transmission transfrontalière. Une plate-forme whatsapp a été développée pour permettre un suivi en temps réel des épidémies. Elle est maintenant opérationnelle et est utilisée pour transmettre les mises à jour de la Guinée aux équipes de surveillance et d’intervention des pays membres.
Cependant, comme me l’a fait remarquer Pierre Formenty, le chef de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé chargée des virus et des fièvres hémorragiques : la pire erreur que l’on puisse faire à propos du virus Ebola est de le sous-estimer ou de croire que l’on sait tout sur lui.
Expert en maladies infectieuses, j’ai dirigé plusieurs équipes nationales de réponse sanitaire lors de précédentes épidémies d’Ebola. Une leçon fondamentale que m’ont apprise ces expériences est que le succès d’une stratégie de lutte ne dépend pas des informations les plus évidentes à disposition, mais plutôt sur certaines questions plus subtiles qui demeurent sans réponse. Cela, je l’ai appris à la dure.
Un incident particulier m’est resté en mémoire. Au début du mois d’août 2014, j’ai rencontré le représentant de l’OMS au Liberia qui m’a demandé comment se portait West Point, le plus grand bidonville du Liberia, situé à Monrovia, la capitale du pays. Je lui ai répondu, sûr de moi, que la situation y était très calme et qu’il n’y avait pas de transmission d’Ebola en cours. En réalité, au moment précis où je lui parlais, le virus Ebola se transmettait activement dans la zone, et des enterrements secrets avaient lieu au petit matin. Résultat : à West Point, le nombre de cas a explosé.
Il est donc crucial de ne jamais cesser les investigations, et de continuer à interroger les gens.
À cet effet, j’ai compilé une série de questions clés essentielles pour définir les stratégies de préparation à l’épidémie. Des questions auxquelles chacun des pays de la région devrait s’attacher à répondre.
Les personnes chargées de la surveillance et du traçage des contacts doivent répondre à certaines questions biologiques essentielles.
1) La première question à se poser est la suivante : durant combien de temps le premier cas identifié a-t-il été malade avant de décéder ?
Connaître la réponse à cette question est crucial pour que les pays voisins puissent déterminer les fenêtres de temps durant lesquelles une personne infectée, ou un de ses contacts, aurait pu passer leurs frontières. Durant l’épidémie de 2014-2015, de nombreux cas d’infection ont résulté de la dissémination de la maladie par des gens se déplaçant pour échapper au virus ou pour chercher de l’aide.
Le virus Ebola ne tue pas en 24 h : sa période d’incubation est comprise entre deux et 21 jours. À mesure que le virus se multiplie dans leur corps, la maladie des personnes infectées s’aggrave. Certaines études sur l’épidémie précédente en Guinée ont mis en évidence que la durée moyenne entre l’apparition des symptômes et le décès était de huit jours.
Disposer d’une frise chronologique est donc crucial pour pouvoir déterminer à qui les personnes infectées ont pu transmettre le virus.
2) Seconde question majeure : quelle est la source de l’infection ? Comment les victimes ont-elles été infectées ?