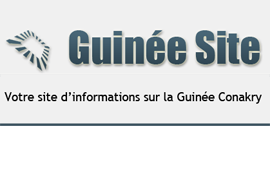Ces débats, polémiques et affaires qui ont agité le sport en 2019
Racisme dans les stades, compétitions dans des conditions climatiques extrêmes, athlètes hyperandrogènes, dopage russe… L’année 2019 a été marquée par un certain nombre de débats, polémiques et affaires.
De la dénonciation de la faible implication des autorités du football face au racisme dans les stades, aux interrogations sur la façon dont les grandes compétitions internationales tiennent compte des conditions climatiques extrêmes, en passant par le traitement réservé aux athlètes hyperandrogènes, privées de Mondiaux, l’année 2019 a été marquée par un certain nombre de débats, polémiques et affaires. Tour d’horizon non exhaustif et forcément un peu subjectif aussi.
La résurgence des comportements racistes dans les stades.
Il supporte le club de football de Burnley, n’a que 13 ans, et fait l’objet d’une enquête de police pour un geste raciste adressé au joueur Sud-Coréen de Tottenham Heug-min Son. Triste et récente illustration d’un fléau qui n’a jamais vraiment disparu des stades mais qui a connu un regain cette année.
L’Italie est particulièrement touchée par cette gangrène. En quinze journées de championnat italien de football, une dizaine d’incidents racistes ont été répertoriés. Le ton aura été donné dès la deuxième journée, le 1er septembre, avec les cris racistes contre l’attaquant belge Romelu Lukaku, à peine arrivé à l’Inter Milan depuis le club anglais de Manchester United.
Signe d’un mal profond, le joueur de Brescia Mario Balotelli, qui avait vivement réagi aux insultes racistes des supporteurs de Vérone, a également été visé par son propre président : « Qu’est-ce qu’il se passe avec Balotelli ? Il se passe qu’il est noir, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. Il travaille pour s’éclaircir, mais il a des difficultés »
L’association mondiale des Ligues de football professionnel a annoncé, le 15 novembre, la création d’un comité contre le racisme. Pas sûr que cela soit suffisant pour enrayer le racisme dans les stades, toujours aussi faiblement combattu et sanctionné par les clubs et les instances concernés.
N’aurait-on pas pu anticiper qu’en organisant des championnats du monde d’athlétisme à Doha, au Qatar, même décalés de début août à fin septembre, les athlètes seraient soumis à des conditions climatiques (chaleur, humidité) extrêmes ?
De la même façon, comment ne pas avoir pris en compte le fait qu’en organisant, entre fin septembre et début novembre, une compétition au Japon - le Mondial de rugby - on prenait le risque que celle-ci soit perturbée par des typhons ?
Les débats liés au climat font de plus en plus l’actualité. Cette année ils se sont aussi invités dans le sport.
A Doha, hormis le fait que le stade était climatisé - ce qui n’est pas le summum d’un point de vue écologique -, c’est surtout pour les épreuves en extérieur (marathon, 50 et 20 km marche) que le débat s’est envenimé. Bien que ces épreuves aient été décalées en milieu de nuit pour éviter les températures importantes, les athlètes ne s’en sont pas mieux portés pour autant : il y a eu 28 abandons lors du marathon femme (68 partantes).
Ces polémiques ont conduit le Comité international olympique à annoncer que, pour les JO 2020, les épreuves de marathon et de marche seront déplacées de Tokyo à Sapporo, 1 000 km plus au nord, où les températures devraient être plus clémentes fin juillet-début août.
La championne sud-africaine Caster Semenya est l’athlète hyperandrogène (taux de testostérone supérieur ou égal à 5 nanomol/litre) la plus connue. Elle incarne à elle seule le règlement controversé de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) : triple championne du monde du 800 m, plus rapide d’environ trois secondes cette année que toutes ses rivales, elle n’a pu s’aligner au départ du double tour de piste des Mondiaux de Doha, finalement remporté par l’Ougandaise Halimah Nakaayi, le 30 septembre.
Le règlement de l’IAAF a en effet rendu impossible la participation d’une dizaine de sportives aux épreuves du 400 jusqu’au 1 500 m. Ce texte a été validé en mai par le Tribunal arbitral du sport (TAS) - qui l’a pourtant reconnu discriminatoire - avant d’être autorisé en attendant une décision en appel de la justice suisse (la Cour suprême en juillet).
Les instances de l’athlétisme offrent trois options à ces athlètes : courir avec les hommes, subir un traitement médical (médicaments ou chirurgie) ou changer de discipline.
Ce feuilleton ne cesse de revenir sur le devant de la scène depuis l’émergence au plus haut niveau de Semenya, victorieuse du 800 m des Mondiaux de Berlin en 2009. Quelques heures avant la finale, l’IAAF avait officialisé l’ouverture d’une enquête sur « le sexe » de l’athlète.
En plein Mondiaux de Doha, une enquête de la chaîne allemande ARD a aussi révélé les graves séquelles psychologiques et physiques d’au moins deux athlètes hyperandrogènes, dont l’Ougandaise Annet Negesa, à qui le service médical de l’IAAF aurait fait subir en 2012 une gonadectomie, sans réelle information préalable, ni suivi médical a posteriori.
Les manipulations russes sur les contrôles antidopages.
Après une saison 4 décevante et semblant signer la fin du feuilleton qui monopolise l’attention de la lutte antidopage depuis 2015, l’affaire du dopage d’Etat russe a spectaculairement rebondi lors de cette cinquième saison. L’Agence mondiale antidopage, longtemps cantonnée au rôle du corniaud, a cette fois trouvé des ressources insoupçonnées : elle a découvert que des données de l’ancien laboratoire antidopage de Moscou, transmises par la Russie pour solder les comptes de l’ère du dopage organisé, avaient été manipulées.
En décembre, elle a sanctionné cette énième incartade d’une radiation de quatre ans de la Russie des compétitions mondiales, à commencer par les Jeux olympiques de Tokyo. Ses athlètes - à condition qu’ils n’aient pas été identifiés comme ayant bénéficié du système en cours jusqu’en 2015 - devront concourir sous bannière neutre et le pays ne pourra pas accueillir de compétition mondiale (ce qui n’inclut pas l’Euro de football). La série connaîtra une saison 6 : la Russie a fait appel de la décision devant le Tribunal arbitral du Sport, dont l’arbitrage est attendu avant l’été.
L’année 2019 aura été rude, une fois de plus, pour les limiers de l’antidopage, qui découvrent l’ampleur des mesures mises en place par les dopeurs pour leur échapper. L’Agence américaine antidopage, au bout d’une longue enquête et de débats prolongés avec les juristes de Nike, a suspendu Alberto Salazar, à la tête du groupe d’entraînement d’athlétisme baptisé Nike Oregon Project, qui avait fait la fortune du Britannique Mo Farah. Ses succès, et ceux de ses successeurs, sont désormais entachés de soupçon.
Les polices autrichienne et allemande ont mis au jour un système de dopage sanguin à l’échelle européenne, omnisports, qui a fait prendre conscience aux chercheurs de leurs lacunes. Il livrera ses derniers secrets l’an prochain.
Quant à l’athlétisme français, il donne dans le rocambolesque. Au feuilleton du contrôle antidopage raté au Maroc impliquant Clémence Calvin - finalement suspendue 4 ans -, a succédé celui du contrôle positif à l’EPO d’Ophélie Claude-Boxberger : elle accuse son beau-père de lui avoir injecté une seringue à son insu, réveillant les mânes de Richard Virenque.
Et le cyclisme, d’ailleurs ? L’absence de contrôle positif est-il le signe que le combat est presque gagné, ou que la lutte n’est pas suffisamment rigoureuse ? Les équipes réunies au sein du Mouvement pour un cyclisme crédible penchent pour la deuxième hypothèse, inquiètes des performances en augmentation. L’année 2020 apportera-t-elle une réponse ?
L’assistance vidéo à l’arbitrage divise toujours dans le football
« Je pense que la VAR est une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière. » Michel Platini, ancien patron de l’UEFA, a résumé en langage fleuri la pensée d’une bonne partie des acteurs et amateurs de football. Désormais généralisée dans presque toutes les compétitions nationales et internationales, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a encore fait parler d’elle cette année.
Après les mains plus ou moins volontaires dans la surface, deux faits de jeu ont été particulièrement débattus : les hors-jeu sifflés au centimètre près, et la possibilité de retour sur l’ensemble d’une action de jeu, illustrée notamment lors du match du PSG face au Real Madrid en match de poules de la Ligue des champions, fin novembre.
Juste avant la pause, l’arbitre adresse un carton rouge au gardien du Real, Thibaut Courtois, pour une faute sur Mauro Icardi. Penalty pour Paris alors que Madrid mène 1-0. Une douzaine de secondes plus tard, penalty et carton rouge annulés. Une décision prise après un recours à l’arbitrage vidéo pour… une faute bien antérieure (et hors de la surface) d’Idrissa Gueye sur Marcelo.
Les lois du football 2018-2019 sont formelles : la VAR est applicable sur l’intégralité de la « phase offensive » précédant l’action en question, peu importe la confusion engendrée par ce recours tardif à l’arbitrage vidéo. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a demandé à l’International Board, le garant des règles du football, une clarification de l’usage de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans certains cas litigieux. « Il y a certaines choses qui ne sont pas claires et que nous aimerions qu’on clarifie. »